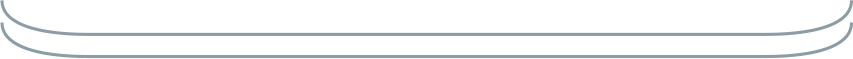La trajectoire d’un cinéaste qui nous tient à cœur depuis ses débuts, présentée en un seul bouquet de surprises, d'œuvres négligées et de nouveautés incontournables.

La première fois que j’ai vu un film d’Olivier Godin en public, c’était dans le cadre d’un cinéclub, Le Phosphène, alors organisé au Eastern Bloc, le 27 avril 2011. Le cinéaste était à cette époque une des éminences de la Boîte noire, le mythique club vidéo, et il venait de terminer son premier long métrage, encore ignoré à peu près partout. Pour ma part, il me revenait d’animer une discussion d’après-projection entre Godin et une distributrice qui avait un succès d’estime assez épatant. Si le film a certainement plu au petit public qui s’était réuni — les étudiant-e-s de cinéma qui ont du flair affectionnent toujours les films de Godin, sans doute parce que peu de cinéastes donnent autant l’envie d’écrire et de filmer —, c’était tout le contraire pour la distributrice, qui cachait à peine son malaise sous le couvert de sa politesse. Elle avait été invitée car elle avait du talent pour vendre des films qu’on pensait alors sans public sur le marché québécois et le cinéclub avait pensé bien faire en présentant le travail d’un cinéaste en lequel nous croyions déjà, même s’il apparaissait évident qu’il détonnait dans le paysage au point d’être soi-disant « invendable ». Quelques semaines plus tard, le Festival du nouveau cinéma annonçait à Godin qu’ils avaient enfin sélectionné son film et qu’il aurait droit à deux projections en salle à l’automne 2011.
*
L’impulsion derrière cette programmation est double : d’abord le plaisir de présenter en un seul bouquet la trajectoire d’un cinéaste qui nous tient à cœur depuis ses débuts. Ensuite, de recadrer le cinéma d’Olivier Godin sous d’autres considérations que celles de la parole et d’une oralité parfois isolante, à défaut d’être toute puissante. Non pas que son cinéma n’y adhère pas — il s’agit bien d’un des plus singuliers et talentueux dialoguistes de notre cinéma —, mais il semble souvent restreint à cette position verbeuse par le public et la critique, le réflexe occultant finalement les qualités parfois plus plastiques, plus agiles, de ce cinéma qu’il ne faut surtout pas tenir pour acquis ni restreindre à son évidente littérarité.
Ainsi, cette programmation, en creusant certaines œuvres moins connues de son cinéma, vise aussi à restituer un rapport à la surprise qui nous semble fondamentale à son style. Surprises de sa débrouillardise, surprises de ses ambitions si singulières, elles se retrouvent souvent branchées à une parole qui a toujours été incantatoire chez lui. Dans son cinéma, on parle pour appeler, convoquer, faire advenir. On parle aussi pour annoncer les bonds d’un montage qui se plaît à désarçonner, à passer du rituel à ses conséquences, à faire travailler le cinéma à la matérialisation des promesses annoncées par des dialogues érigés en mots magiques.


« Il faut croire pour comprendre », disait saint Augustin, et cela demeure le meilleur exercice pour suivre le cinéma de Godin jusqu’au fond de son terrier imaginaire. Il faut croire aux formules, aux fioles dissimulées, aux malédictions. Croire qu’en se frottant les mains au-dessus d’une feuille de papier, la fée Morgane finira par apparaître. Croire que les conversations téléphoniques, légions chez lui, peuvent être des dispositifs qui permettent à la parole d’atteindre l’autorité qu’elles nécessitent pour nous transporter dans d’autres espaces et époques, nous faire imaginer des pompiers secrets, des dépeupleurs intimidants, des détectives de banc de parc, des itinérants équipés de grandes épées. Vous ne les verrez pas vraiment à l’écran — ou enfin si, dans leur forme la plus civile, la plus tenable — mais vous les verrez assurément dans votre esprit, à condition de bien écouter les contes et légendes de Godin.
Cela ne veut pas dire que tout est bêtement explicatif ou que personne ne ment dans son cinéma, car au contraire, la tromperie est légion, avec des mensonges, des entourloupettes, pour ravir des cœurs ou des cigarettes. Ce programme s’appelle « De la parole aux gestes » mais il aurait même pu s’appeler « Des téléphones et des clopes », tellement ces accessoires me semblent indissociables de ce cinéma de parole qui la déconstruit, ce cinéma de postures qui les défait. Ainsi il faut avoir en tête en regardant le cinéma de Godin que chaque pose du corps est étudiée non seulement pour sa beauté, mais aussi pour l’accès qu’elle confère aux visages et aux mains de ses personnages (joués par Ève Duranceau, Rose-Maïté Erkoreka ou Étienne Pilon), dont la délicatesse est toujours garante de leur capacité à produire la magie dont ces œuvres discutent et sur laquelle elles carburent. Par ailleurs, il semble tout naturel de constater que son dernier film en date d’aujourd’hui est un film sur une troupe de danse, artistes de la pose élégante qui achèvent de montrer comment la parole appelle le geste et comment le geste doit à son tour se montrer à la hauteur de la parole.
Cette réciprocité de l’oralité et de l’action, on pourrait longtemps expliquer de qui il la tient (d’un savant mélange entre le baroque de Raúl Ruiz, les aventures pleines d’artéfacts de Conan le Cimmérien, en passant par la force d’incarnation d’un Yves Thériault), mais ces discussions ont déjà été menées et il ne nous appartient pas d’encore refaire l’inventaire de ses influences nombreuses (sur lesquelles il a largement écrit, chez nous ou plus encore chez Hors Champ). On pourrait en ajouter évidemment, avec en plus l’authentique cahier bleu sous le coude que le cinéaste nous a gracieusement prêté afin de vous en livrer une version numérique intégrale, mais à ce point-ci il convient surtout de vous présenter son travail en vous disant qu’il nécessite une écoute et une curiosité qu’il vous rendra en triple.


Les histoires de Godin ouvrent sur des conditions fantasques, qui se matérialisent à l’écran dans une p-r-o-n-o-n-c-i-a-t-i-o-n dont il a le secret, sous le couvert d’une mise en scène parfaitement attentive à ses interprètes et à un programme de libération imaginaire qu’il leur propose projet après projet. Il y a un univers unique au cinéma de Godin que le programme tente ici de retracer en incluant ses œuvres de jeunesse autant que ses deux plus récents opus, et cet univers semble être de plus en plus actif, réactif. Il y a un mariage au mouvement qui s’est effectué depuis les tableaux nordiques de ses premiers films, une alliance aux gestes, à l’adhésion d’un mouvement impétueux qu’on voyait peut-être pour une première fois dans ce travelling arrière de Dracula Sex Tape (2021), qu’on retrouve dans la caméra sportive d’Irlande cahier bleu (2023), voire dans les panoramiques comiques et rapides des balançoires de La suite canadienne (2023). Aucun mouvement ne semble gratuit, car tous proviennent d’une patiente préparation, d’un artisanat qui s’est longtemps demandé de quoi il était constitué tout en s’accrochant à ses acquis, à ses talents géniaux, jusqu’au point d’être aujourd’hui en mesure de jouer de ses allures, de faire de son oralité moins une quête de complétion qu’un passage vers autre chose, une suite qui reste à venir et qui fait de ses deux derniers films le point pivot idéal pour réfléchir le premier grand chapitre de son travail.
*
Aujourd’hui les films d’Olivier Godin sortent en salles régulières, ils sont sélectionnés dans des festivals internationaux alors que la compagnie de la distributrice qui était présente à son baptême a disparu dans les sables du temps. Cette anecdote n’a rien à dire sur le sort de cette compagnie de distribution, elle souhaite surtout pointer ce temps qui passe, et toute la persévérance de ce cinéaste dont les voyages imaginaires ont servi la quête d’un retour qu’il n’a cessé d’entretenir et d’élargir au fil des années : revenir de la réalité afin de s’enfouir dans la fantaisie, et ce faisant, de redonner à la parole toute sa force à produire les gestes dont nous avons besoin pour rêver et les mains qu’il faut pour nommer.